
Allaitement et pollution

Les médias se font régulièrement l’écho d’analyses montrant la présence de polluants dans le lait maternel. Au risque d’inquiéter les mères qui allaitent et de détourner de l’allaitement celles qui se posent la question. Faut-il vraiment s’en inquiéter ? Cela remet-il en cause l’intérêt de l’allaitement ?
En 2003, une campagne de la Fondation Nicolas Hulot visant à dénoncer la pollution affichait sur des panneaux de quatre mètres sur trois un sein de femme d’où s’écoulait un liquide noirâtre.
Une image choc. Mais à quelle réalité correspondait-elle ?
Pourquoi des polluants dans le lait maternel ?
Beaucoup de polluants organiques sont lipophiles : ils s’accumulent dans notre organisme et sont stockés dans les graisses. Or, pendant l’allaitement, ces graisses sont mobilisées : on estime qu’environ 60 % des lipides présents dans le lait maternel proviennent des réserves lipidiques maternelles, et leur mobilisation induit le passage dans le sang et le lait des polluants qui y étaient stockés [1]. C’est d’ailleurs pour cette raison que le lait maternel, étant un fluide corporel facile à recueillir et à analyser, est régulièrement utilisé pour évaluer le niveau de contamination d’une population dans son ensemble.
Même pollué, le lait maternel reste le meilleur
Mais toutes les études sur le sujet montrent que, si l’exposition aux polluants in utero peut vraiment avoir des conséquences dommageables pour l’enfant à naître, l’allaitement les atténue, et ses avantages pour le développement neurologique de l’enfant et sa santé en général contrebalancent largement l’éventuel impact négatif que pourrait engendrer la présence de polluants dans le lait maternel.
Par exemple, de toutes les études épidémiologiques réalisées pour évaluer les effets des dioxines chez les enfants allaités, aucune n’a retrouvé d’impact sur la croissance staturo-pondérale, la taille du foie, la morbidité infantile ou le développement neurologique.
En ce qui concerne le DDE (dichlorodiphenyldichloroethylene), un polluant organochloré, une étude espagnole [2] a montré que si le risque d’asthme était corrélé au taux de DDE à la naissance, à 4 ans, le risque était significativement plus bas chez les enfants qui avaient été allaités, et ce chez tous les enfants, de façon indépendante de leur taux de DDE.
Une autre étude [3] a conclu que si l’exposition aux PCBs (polychlorobiphényles) pendant la grossesse a bien un impact négatif sur le développement du système nerveux central, celui-ci est compensé en cas d’allaitement, et ce en dépit de la poursuite d’une exposition éventuellement élevée aux PCBs : les enfants ainsi exposés, qui avaient été allaités moins de 16 semaines ou qui n’avaient pas été allaités, avaient de moins bons résultats aux tests que ceux qui avaient été allaités au moins seize semaines.
La consigne donnée il y a quelques années par certains mouvements écologistes allemands de n’allaiter que les premiers mois est donc bien absurde, d’autant que l’on sait qu’au fil de l’allaitement, le taux lacté de polluants organiques diminue régulièrement (dans une étude japonaise [4], la baisse était d’environ 70 % au cours des douze premiers mois post-partum). Il est également plus bas lors d’un deuxième ou troisième allaitement que pour le premier.
Lutter contre la pollution au niveau général
Cela n’empêche pas de tout mettre en œuvre pour un environnement plus sain, qui entraînerait automatiquement une diminution de la pollution du lait maternel. C’est d’ailleurs ce qui s’est déjà produit dans certains pays. Comme le signalait en 2003 l’appel conjoint WABA/IPEN, « en Suède, des programmes gouvernementaux efficaces pour réduire la présence de polluants organiques persistants comme le DDT, la dieldrine, les PCBs et les dioxines ont permis une diminution spectaculaire de ces contaminants dans le lait maternel. Aux États-Unis, les interdictions du plomb dans l’essence et de la cigarette dans les lieux publics ont eu comme conséquence une réduction importante du taux sanguin de dangereux produits chimiques chez les jeunes enfants. »
Un institut allemand qui, au cours des trente dernières années, a analysé des milliers d’échantillons de lait humain pour y doser les taux de polluants a observé que ces taux ont significativement baissé au cours de cette période [5].
Minimiser les risques au niveau individuel
Les polluants dans le lait maternel viennent à la fois de ceux qui se sont accumulés dans l’organisme tout au long de la vie et qui sont « remis en circulation » pendant l’allaitement, et de ceux auxquels la mère est exposée pendant la période d’allaitement. Pour les premiers, on peut envisager de suivre, avant la conception, le programme élaboré par Michel Odent (« méthode accordéon ») qui vise justement à éliminer le plus possible les toxines accumulées dans le corps [6].
Pour minimiser les seconds, on peut adopter certaines mesures :
- Laver et/ou éplucher soigneusement fruits et légumes, afin d’éliminer les résidus présents sur leur surface ;
- Limiter la consommation de produits laitiers. Leurs graisses en particulier (surtout en ce qui concerne le beurre) concentrent les polluants liposolubles ;
- Limiter la consommation de viande, et préférer les viandes maigres, pour les mêmes raisons que ci-dessus [7] ;
- Éviter les poissons de rivière ou de mer qui sont en bout de chaîne alimentaire et sont donc les plus susceptibles d’être pollués par les PCBs et le mercure (par exemple, le thon) ;
- Préférer les produits qui sont en début de chaîne alimentaire à ceux qui sont en fin de chaîne. Par exemple, préférer les céréales à la viande : les animaux qui consomment des céréales polluées concentrent les polluants dans leur corps ;
- Éviter les pertes de poids importantes pendant l’allaitement, qui remettraient en circulation dans le sang tous les polluants stockés dans les graisses, en particulier les PCBs ;
- Éviter de fumer et de boire de l’alcool pendant l’allaitement. Des études ont montré que les personnes qui consomment tabac et alcool ont des taux sanguins plus élevés en ce qui concerne de nombreux polluants ;
- Limiter l’utilisation domestique (maison, jardin) des pesticides, insecticides, désinfectants, détachants, produits de traitement du bois, peinture, solvants… ;
- Éviter les lieux récemment traités contre les termites ou les cafards. Les produits utilisés pour ces traitements sont très toxiques, en particulier le chlordane et la dieldrine ;
- Fuir la proximité des décharges et usines d’incinération des déchets, et les produits cultivés à proximité de tels lieux ;
- Dès la grossesse, s’assurer que le lieu de travail présente un maximum de garanties de sécurité pour les femmes enceintes et allaitantes. Le cas échéant, demander à changer de poste, ou à aménager ce poste pour en améliorer les conditions ;
- S’informer sur la pollution engendrée par l’aménagement « tout électrique » des cuisines et lieux de travail (PCBs en particulier), et agir en conséquence.
Finalement, quand on allaite, on est dans la vie, pas dans une bulle stérile, et c’est tant mieux. Même si certaines composantes de la vie moderne sont loin d’être idéales pour un bébé, dans tous les cas de figure, il vaut mieux pour lui être allaité que ne pas l’être !
[1] Ce qui fait que, pour la mère, l’allaitement a un « effet détox » certain : une étude réalisée en Suède en 2010 a montré que le fait d’avoir allaité pendant au moins huit mois abaissait significativement le taux de PCBs, de DDE et de chlordanes (insecticides organochlorés) dans l’organisme (Time trends of persistent organic polluants in Sweden during 1993-2007) and relation to age, gender, body mass index, breast-feeding and parity. Hardell E et al. Sci Total Environ 2010 ; 408(20) : 4412-9).
[2] Early exposure to dichlorodiphenyldichloroethylene, breastfeeding and atsthma at age six. Sunyer J et al. Clin exp Allergy 2006 ; 36(10) : 1236-41.
[3] Vreugdenhil HJ et al, Prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and breastfeeding : opposing effects on auditory P300 latencies in 9-years-old Dutch children, Dev Med Child Neurol 2004 ; 46(6) : 398-405.
[4] Ratio variation of congener profiles of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in human milk during lactation. Takekuma M et al. Sci Total Environ 2011 ; 409(8) : 1368-77.
[5] Dioxins, polychlorinated biphenyls and other organohalogen compounds in human milk. Levels, correlations, trends and exposure through breastfeeding. Furst P. Mol Nutr Food Res 2006 ; 50(10) : 922-33.
[6] Voir ICI
[7] Dans une étude américaine de 2010, le taux lacté du polluant étudié (diphényléthers polybromés) était corrélé à la consommation de graisses saturées en post-partum et à la pollution du domicile.
Cet article est paru dans le n° 36 de Grandir autrement, septembre-octobre 2012.







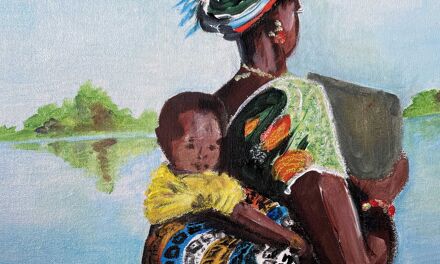
Bonjour,
Merci pour cet excellent article.
Je suis maman d’un bébé de 9 mois allaité jusque là et je souhaiterais continuer l’allaitement. Le problème c’est que j’ai des dents soignées avec des composites blanches (résines) et deux dents avec des amalgames au mercure depuis 15 ans . J’ai lu que le mercure passe la barrière placentaire et contamine le lait maternel également. Par conséquent je m’interroge avec beaucoup d’inquiétude sur les bienfaits/dangers d’un allaitement prolongé à 12 mois voir plus, sachant que le mercure causerait des maladies dangereuses dégénératives comme l’autisme.
lola38
Si vous allez voir cet article sur le site de La Leche League :
http://www.lllfrance.org/vous-informer/fonds-documentaire/allaiter-aujourd-hui-extraits/1655-aa-92-la-sante-dentaire-de-lenfant-allaite-et-de-sa-mere (comme toujours très complet !), vous y lirez que « le port d’amalgames ne contre-indique en rien l’allaitement, et il est utile de savoir que, comme pour beaucoup de polluants et toxiques, c’est pendant la grossesse que s’effectue un transport important vers le foetus, et non pendant l’allaitement ».
Ce qui peut poser problème, c’est la dépose de ces amalgames, pas le fait d’en avoir.